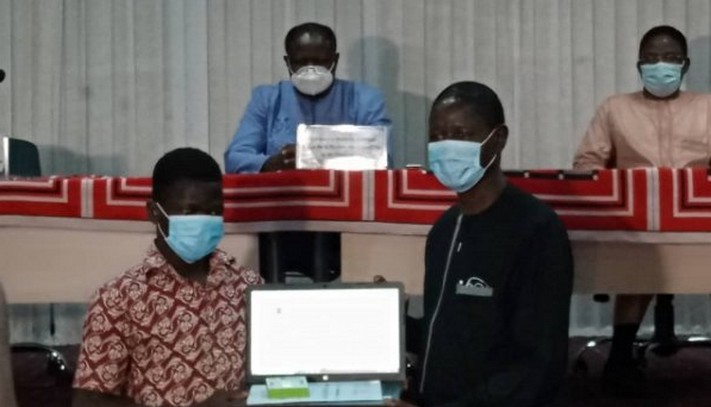E-agriculture

Pour Ken Lohento, de la documentation à l’agriculture, il n’y a qu’un pont : les technologies de l’information et de la communication. A 44 ans, il coordonne depuis 9 ans, au Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale (CTA), des actions et projets liés à l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le domaine agricole et rurale. Globe-trotter et passionné du sujet, il retrace dans cet entretien, son riche parcours de change maker.
Magazine InAfrik : Parlez-nous de votre parcours professionnel et de vos expériences notoires ?
Ken Lohento : Mon parcours professionnel a commencé dès la fin de mes études à l’Ecole Nationale d’Administration du Bénin (actuel ENAM), avec ma mission de consultant pour le réseau international ANAIS qui s’occupait de TIC pour le développement. Après sa création, mon association Oridev, antenne nationale de ce réseau, a été impliquée dans différentes activités internationales. J’ai notamment coordonné la participation béninoise à la rencontre internationale Bamako 2000, l’un des premiers grands sommets sur l’utilisation de l’internet pour le développement en Afrique. Cette rencontre avait été organisée en collaboration avec l’ex Président Alpha Oumar Konaré du Mali, l’un des co-fondateurs du réseau ANAIS (le second étant une autorité suisse).
Par la suite, après l’obtention de mon diplôme de DEA en France, j’ai été recruté au siège de l’UNESCO comme Consultant, où j’ai appuyé la mise en place de télécentres communautaires dans divers pays africains. Mais mon épouse et moi n’avions plus envie de rester en Europe en ce moment-là. J’ai examiné plusieurs opportunités de travailler en Afrique, y compris au Bénin, et j’ai finalement accepté une offre spontanée de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) au Sénégal. Il me proposait de diriger un projet de Centre International sur les Politiques des TIC pour l’Afrique de l’Ouest, un centre virtuel, financé par la coopération britannique dans le cadre d’un programme plus grand appelé CATIA.
Donc vous démarrez une nouvelle aventure professionnelle au Sénégal…
Oui, j’ai donc débarqué au Sénégal, une semaine après avoir bouclé un premier contrat de consultant à l’UNESCO. Je suis resté au Sénégal pendant près de 6 ans. La coopération britannique n’a plus octroyé de financement au programme CATIA après deux ans, je suis devenu coordonnateur de programme TIC pour l’IPAO. Dans cette période, au-delà des activités propres à l’IPAO, j’ai contribué à la coordination intellectuelle et logistique de la participation de la société civile africaine à la seconde phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) et au Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI) qui a suivi le SMSI. J’ai été nommé par les Nations-Unies dans le Comité Conseil du FGI, de 2006 à 2009, participant à l’organisation de trois sommets internationaux du FGI.
En 2009, j’ai démissionné de moi-même pour laisser place à un autre représentant africain. La même année, j’ai eu l’opportunité d’être engagé au CTA aux Pays-Bas et ai quitté l’IPAO et suis revenu en Europe. Depuis, je coordonne différents projets couvrant les pays ACP, avec au cœur de mes activités actuelles, le soutien aux jeunes start-ups numériques et aux entrepreneurs agricoles.
Quid de Oridev depuis ?
Oridev n’est plus active aujourd’hui. Mais, dès que nous serons plus disponibles, Oridev renaîtra sans doute. D’ailleurs, j’ai toujours conservé mon adresse email sur le domaine Oridev.org.
Vous vous occupez aujourd’hui des questions liées à l’agriculture, quel est l’état des lieux de la pratique agricole en Afrique subsaharienne ?
Grande question, on pourrait rédiger un livre sur ce sujet. Mais en gros, l’agriculture africaine souffre encore de beaucoup de problèmes de productivité, de mécanisation, de faibles rendements, de problèmes de rentabilité pour le petit paysan, et souffre énormément des conséquences du changement climatique. Mais elle demeure le secteur employant près de 70% des populations actives africaines, nous fournissant en moyenne 30% de notre PIB.
Comme vient de le démontrer une récente étude de l’OCDE, pendant plusieurs années encore, ce sera le secteur qui apportera une solution à la problématique du chômage et du sous-emploi. La Banque mondiale a, dans une étude, affirmé en 2013 que le marché de l’agro-alimentaire africain pourrait générer 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. Il est alors impératif de moderniser le secteur, de le rendre plus compétitif, notamment en développant les entreprises et les innovations agro-alimentaires africaines.
Agriculture, technologies de l’information et jeunesse : n’est-ce pas un mariage forcé ?
Absolument pas ! Au départ, c’était un mariage de raison, mais cela devient un mariage d’amour. Mariage de raison du fait de différentes considérations. Le lien entre jeunesse et agriculture est naturel et fondamental. Premièrement, l’agriculture a besoin des jeunes pour qu’ils lui apporter plus d’innovations et une force vigoureuse de travail ; et dans le même temps, le secteur agro-alimentaire est le domaine qui peut le plus offrir des opportunités d’emplois aux plus de dix millions de diplômés sortant de nos écoles et universités africaines chaque année. Les jeunes de 18 à 35 ans connaissent un fort taux de chômage et de sous-emploi en Afrique. Par exemple au Burkina Faso, selon les statistiques de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi, les jeunes représentent 85% des demandeurs d’emploi et selon une autre étude, 77% des jeunes occupés dans ce pays sont dans le secteur agricole.
La situation devrait être plus ou moins analogue dans plusieurs pays africains. Si l’on considère le secteur agricole dans toute sa chaîne de valeur (depuis la production agricole jusqu’à la fourniture de l’alimentation au consommateur final, en passant par la transformation et la commercialisation des produits agro-alimentaires), les opportunités sont immenses pour les jeunes. Il faut voir l’agriculture comme ce vaste secteur englobant également la pêche, la foresterie et l’élevage, en dehors de la production végétale.
Ensuite, le lien entre jeunesse et TIC est sans doute encore plus naturel, parce qu’on sait tous que les jeunes aiment les technologies. Vu les relations catalytiques entre jeunesse et agriculture d’une part et jeunesse et TIC de l’autre, mettre en liaison ces trois domaines devient synergique, d’autant plus que l’agriculture, tout comme les autres secteurs économiques, a besoin des technologies numériques sur toute sa chaîne de valeur.
En tout cas, c’est la réflexion que je me suis faite quand j’ai été recruté au CTA et qu’on m’a demandé de proposer un programme de travail. C’est ainsi que j’ai initié le projet ARDYIS (le sigle est en anglais mais signifie « Agriculture, Développement Rural et Jeunesse dans la Société de l’Information ») fin 2009. Ce programme a aujourd’hui donné lieu à différents projets et activités, tels que les concours de blogs agricoles, l’initiative AgriHack Talent qui inclut la réalisation d’hackathons agricoles, les concours de start-ups e-agricoles Pitch AgriHack, l’incubation des entrepreneurs, etc. Ces activités sont aujourd’hui répliquées par d’autres organisations nationales et internationales.
L’année dernière, un collègue a lancé l’offre de services de drones agricoles par des entrepreneurs qui sont dans beaucoup de cas jeunes, ce qui montre que les opportunités dans ce créneau sont insoupçonnées et encore à venir. Le CTA est dès lors considéré comme un pionnier au niveau international sur toutes ces questions.
Et le mariage jeunesse, agriculture et TIC, devient un mariage d’amour, pourvoyeur d’emplois et de progrès socio-économique.
Y a-t-il de l’espoir ?
Le doute n’est absolument pas permis dans mon entendement. Mais la route est longue et escarpée. Il nous faut nous armer davantage de persévérance, d’innovations, d’esprit entrepreneurial, d’éthique et de meilleure gouvernance.
En deux mots, peut-on vous décrire comme un « Change Maker » ?
Pourquoi pas ? (sourire). Officiellement personne ne m’a donné ce titre, mais j’ai toujours été profondément excité et mobilisé par contribuer au changement social et à l’innovation sociale. J’étais comédien au Bénin (une autre vie), et avec mes deux groupes (le C.AC. Kpanligan et le Groupe BK avec feu le comédien Dah Badou), nous avions développé beaucoup de sketches et d’animations culturelles télévisées ou non, pour sensibiliser la population et les acteurs publics sur la bonne citoyenneté et la bonne gouvernance. Dans le domaine des TIC, j’ai toujours œuvré pour former la jeunesse, les institutionnels (depuis Oridev), aider le secteur privé et surtout la société civile à être acteurs proactifs de la gouvernance publique (ma vie à Panos) et aider la jeunesse à innover et entreprendre pour développer ses propres opportunités et contribuer au progrès socio-économique (cœur de mon action au CTA).
Deux de mes projets au CTA ont d’ailleurs été récompensés au niveau international par le « Prix du Forum SMSI. » En 2013, il s’agissait du programme de formation des acteurs agricoles aux médias sociaux « Web2PourDev », initié par un collègue et auquel j’ai contribué. En 2015, c’est le programme ARDYIS qui a été primé à l’issue d’un vote public international et d’une sélection finale par des experts. Des start-ups avec lesquelles j’ai travaillé ont déjà mobilisé plus de deux millions d’euros d’investissement et rendent des services à quelques centaines de milliers d’acteurs agricoles.
En Afrique, les communautés paysannes sont pour la plupart analphabètes et l’internet n’est pas accessible à tous. Comment rendre effective l’e-agriculture ?
L’e-agriculture est déjà une réalité malgré l’analphabétisme. Il y quelques années, il a été montré par un compatriote que 41% des riziculteurs au centre du Bénin utilisent le téléphone mobile pour leurs activités agricoles. Aujourd’hui, presque tous les adultes, y compris en milieu rural, disposent d’un téléphone mobile en Afrique. Sur le continent, il y a plus de 800 000 de connexions de cartes SIM (soit près de 80% de taux de pénétration – ceci est différent des abonnés uniques). Par le téléphone basique, notamment les SMS, les paysans, notamment les plus jeunes, peuvent aujourd’hui dans nombre de pays africains avoir accès aux prix des produits agricoles et vendre à un marché plus vaste.
Whatsapp, grâce à sa fonction audio, est utilisable par tous ; les serveurs vocaux interactifs sont utilisés dans le secteur agricole pour diffuser des conseils agricoles. Tout ça, c’est l’e-agriculture ; on n’a pas forcément besoin de satellite ou de haut débit pour en parler. Malheureusement lorsqu’on prend un pays comme le mien, le Bénin, nous sommes encore à la traîne dans ce domaine, malgré des initiatives démarrées depuis les années 2000. En général, les modèles économiques pour rendre durable l’adoption des innovations numériques dans l’agriculture et passer à échelle sont toutefois encore en élaboration, car le domaine est nouveau et complexe, même en Occident.
Qu’est-ce qui explique, de manière générale, les difficultés de financement des startups agricoles en Afrique ?
Le manque de financement des entreprises est une problématique cruciale en Afrique. Selon un rapport publié en 2013 par l’International Finance Corporation, 84 % des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique ne sont pas soient financées ou sont sous-financées. En général, on dit que les jeunes pousses (start-ups) sont financées au départ par les 3F : friends, fools and family (amis, fous, et la famille). En Afrique, la blague est que les 3F signifient plutôt Friends, Fools and Fathers-in-law (beaux-parents).
Fin 2016, le CTA a interrogé 25 start-ups finalistes de notre concours d’entrepreneuriat e-agricole « Pitch AgriHack » sur leur accès au financement. Leurs sources de financement sont multiples mais les économies personnelles (86,96 %), les subventions (43 %) et les dons de membres de la famille et d’amis (39,13 %) représentent les trois principales sources. L’investissement par le capital-risque ou les business angels est ensuite cité par 13,04 % des répondants et, en queue de peloton, on trouve les prêts bancaires (8,7 % des réponses). Les subventions viennent pour l’instant largement d’institutions internationales (fondations d’entreprises ou organisations de développement).
Pourquoi les investisseurs Africains ne misent-ils pas sur l’entrepreneuriat agricole ?
Les investisseurs (surtout les banques je dirais) ne s’intéressent pas suffisamment au secteur agricole à cause des risques inhérents au secteur (aléas climatiques pouvant détruire les productions, manque d’information de marchés fiables, manque d’esprit et de capacités entrepreneuriales au niveau de beaucoup de paysans, d’exploitations, etc.). Certaines banques officiellement agricoles ont dans leurs portfolios moins de 50% de projets agricoles financés. Selon un rapport de la société Dalberg publié en 2016, moins de 25% des besoins financiers des petits agriculteurs des pays en développement sont satisfaits.
Toutefois, le problème d’accès au financement n’est pas toujours le plus déterminant de l’entrepreneuriat africain au niveau des jeunes ; c’est juste parfois un prétexte ou une apparence. Un très grand nombre de start-ups et d’entrepreneurs jeunes ne disposent pas d’une capacité suffisante en matière de gestion comptable et financière, ou en matière de gestion d’entreprise de manière plus générale. Aucune banque, aucun investisseur national ou international sérieux ne confiera ses ressources dans des amateurs. Il est urgent de développer ces compétences au sein des jeunes entreprises. L’Etat et les organisations qui peuvent aider les jeunes, et les aspirants entrepreneurs eux-mêmes sont ici interpellés.
Quel rôle doivent jouer les gouvernants africains dans ce processus ?
Malgré les difficultés, ils doivent trouver les dispositifs financiers nécessaires pour davantage financer à la fois le secteur agricole et celui des TIC, compte tenu de leurs potentiels. Bâtir davantage de partenariats publics/privés, notamment au niveau national, est indispensable. Mais le premier levier de mobilisation des ressources doit être la meilleure gouvernance des deniers publics et de ceux mobilisés par la coopération. Enormément de millions peuvent être libérés grâce à une meilleure gouvernance. Au niveau du financement des start-ups, comme l’illustrent les statistiques précédemment citées, l’appui financier de l’Etat africain est très marginal, même si nous avons quelques prix nationaux ici et là. Il est donc important d’appeler à un renforcement de la contribution de la puissance publique et du secteur privé national dans le financement de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Afrique.
Quels sont vos conseils à la jeunesse africaine que vous rencontrez très souvent ?
Je suis un éternel optimiste, malgré les secousses que la vie dégage, et malgré la complexité de la question du développement en Afrique.
Je suis parfois optimiste par pragmatisme, car, autrement, il ne sert à rien de se lever quotidiennement. Tant qu’on se lève, on doit agir sur son environnement pour le transformer et développer ses opportunités, sinon on n’est qu’une feuille morte trimballée par le vent. Nous devons améliorer notre gouvernance, davantage entreprendre, soutenir l’entrepreneuriat, pour créer de nouveaux emplois ; produire des innovations adaptées à notre contexte local afin de leur donner un avantage comparatif face la compétition, notamment internationale.
A la jeunesse africaine, je recommande cette détermination du Roi Christophe d’Aimé Césaire :
Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagné chaque pas !
Source :.inafrik.com
Propos recueillis par : Mahude DOSSAH / Michaël TCHOKPODO